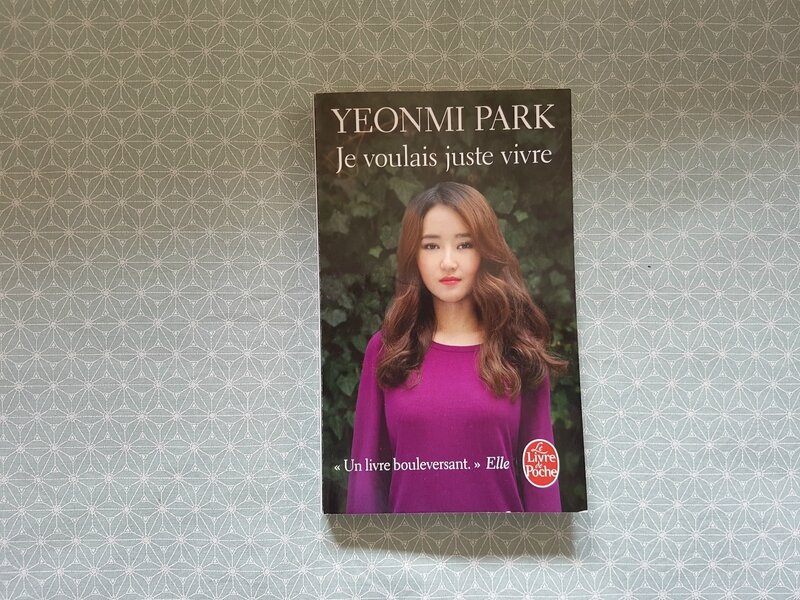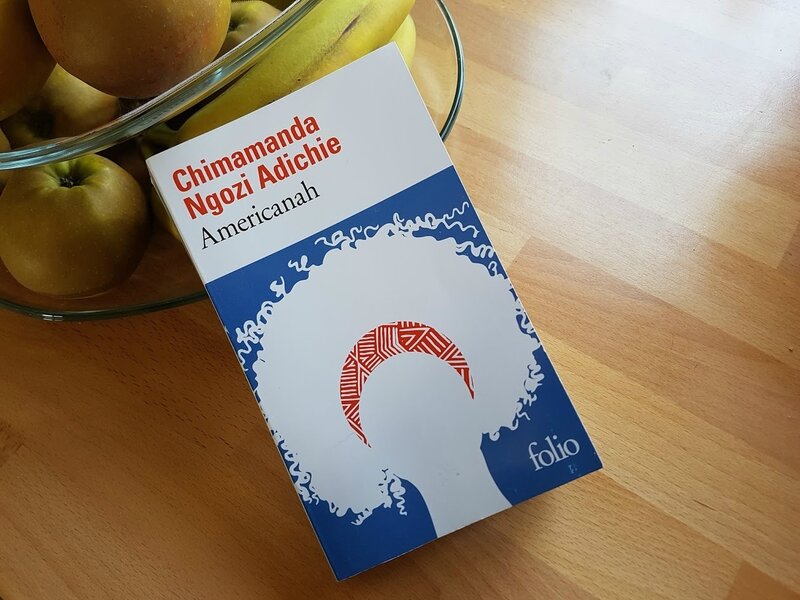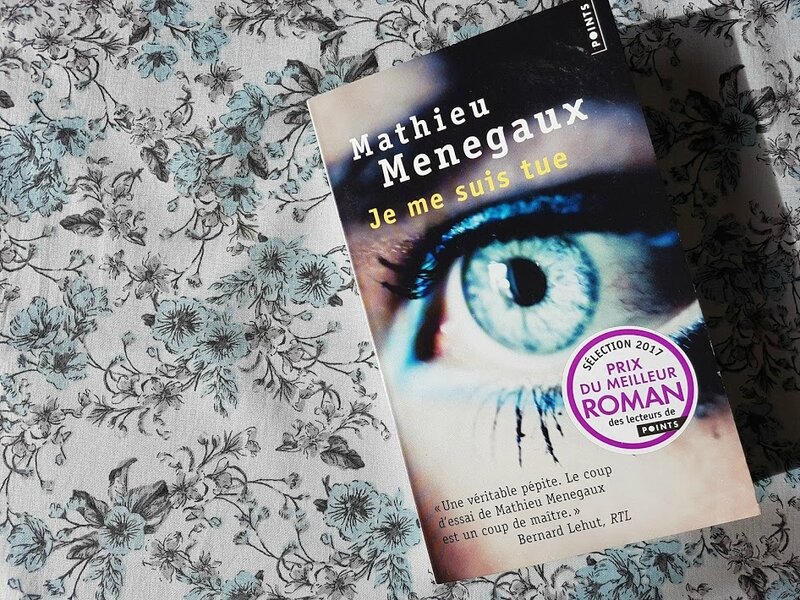Les aventures de Jean le Savoyard, Jeanne Cazin
C'est l'heure de l'enfant malheureux traversant de dures épreuves qui lui forgeront le caractère !
"Le jeune Jean, quatorze ans, doit quitter sa vallée natale et ses parents pour rejoindre sa marraine, la mère Desgranges dont il est l'unique héritier. Elle se fait vieille, et a besoin de lui pour l'aider à gouverner sa propriété. En chemin, Jean fait la rencontre de Justin, dit Tintin, un mauvais drôle qui n'aura de cesse de l'attirer sur les chemins de la perdition... Parviendra-t-il à s'arracher à sa mauvaise influence pour se montrer digne du soin et de l'amour des siens ? "
Rangez les skis, les tartiflettes et le génépi, je vous parle d'une autre Savoie, de la fin du dix-neuvième siècle, de fermes à flancs de montagne, de contrebande de tabac, de soupe à la farine et à la crème, de dangereux glaciers et de torrents indomptables...
Ce pauvre Jean, au début du récit, n'est qu'un "grand enfant" pas très dégourdi. Bref, il est un peu con.
"C'est un étourdi, pouvait-on dire, mais il a bien le temps, le pauvre, de devenir raisonnable." (p. 23)
Il n'avait qu'un trajet à faire tout seul avant de passer sous la tutelle de sa marraine, et il se débrouille tout de même pour se lier d'amitié avec la pire canaille du village. Vous parlez d'un manque de bol. Jean a un bon fond, mais aucune force de caractère : l'envie de s'amuser et de paraître plus indépendant qu'il ne l'est le pousse à suivre les mauvais conseils de Justin, toujours prompt à le provoquer. Heureusement, l'amitié de Mirette, la filleule de sa marraine, ses malheureuses expériences et la générosité de sa famille le remettront dans le droit chemin, vous n'en doutiez pas.
Il y a un intérêt documentaire certain dans ce roman, et j'ai pris un plaisir fou à découvrir la vie de l'époque. On suit bien entendu les travaux de la ferme, mais on découvre également, à l'occasion d'une sortie dans la ville d'à côté, les numéros des saltimbanques; on s'aventure dans les montagnes, sur les chemins des contrebandiers ou sur les glaciers... Gare à votre réputation : les commères colportent les mauvaises nouvelles avec délectation ! Les détails posent le cadre sans jamais assommer le lecteur. Saviez-vous qu'on prévoyait cinq repas par jour pour les laboureurs ? Que les boeufs ne peuvent être utilisés en Savoie en raison du terrain trop accidenté, et qu'on employait des chevaux ?
Jeanne Cazin est une auteure talentueuse, et même si "Les aventures de Jean le Savoyard" n'échappe pas aux conclusions moralisatrices imposées par l'époque, elles sont savamment distillées. Quel dommage que son nom ait disparu de nos classiques jeunesse...
Si vous en avez la patience, je vous propose une brève biographie de Jeanne Cazin, histoire de réparer cette injustice !
Née à Amiens, Jeanne Braive épouse le savant physicien Achille Cazin. Son mari, en plus d'être un scientifique renommé, est un alpiniste passionné, qui acquiert une propriété en Savoie, à Servoz, où il passe tous les étés en famille. Voilà la matière pour l'ensemble des futurs romans de Jeanne !
A la mort de son époux, elle décide de tenter sa chance en littérature pour pourvoir aux besoins de ses deux fils, Maurice et Robert. En 1881 paraît son premier roman, "Les petits montagnards". Elle recevra le prix Montyon [1] à deux reprises, en 1886 et en 1891 , ainsi que le prix Jules Favre [2] en 1907. En 1902, elle sera même nommée officier de l'instruction publique.
Jeanne Cazin décedera à Paris le 7 mai 1925. Elle est aujourd'hui inhumée au Père Lachaise.
Bibliographie :
1881 : Les petits montagnards
1882 : Un drame dans la montagne
1884 : Histoire d'un pauvre petit
1885 : L'enfant des Alpes
1887 : Les saltimbanques
1891 : La roche maudite
1891 : Les aventures de Jean le Savoyard
1893 : Les orphelins bernois
1897 : Perlette
1898 : Le petit chevrier
1906 : Nobles coeurs.
Si vous possédez la moindre info, une photo, un roman non cité dans cette bibliographie, n'hésitez pas à m'en faire part !
[1]Vous vous souvenez du Prix Montyon ? Celui destiné « aux auteurs français d’ouvrages les plus utiles aux mœurs, et recommandables par un caractère d’élévation et d’utilité morales » ?